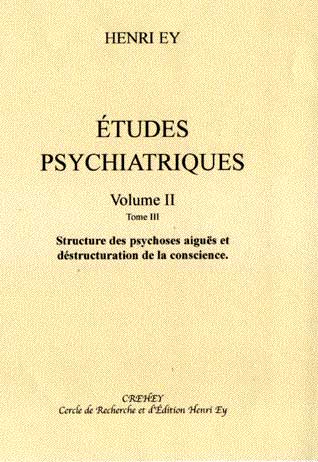INTRODUCTION
L’Etude
N°21 sur la manie de Henri Ey [9] reste encore un des meilleurs textes
cliniques sur le sujet. Le style du texte, le dialogue qu’il établit
avec les textes classiques de la psychiatrie, ou encore avec les indications
discrètes que fait Jaques Lacan sur la manie, est toujours susceptible
d’intéresser les cliniciens. En particulier l’abordage de quelques
points dont la richesse, à la fois clinique, psychopathologique
et épistémologique, font toujours débat.
Ce
texte constitue une remarquable confluence des traditions cliniques française
et allemande, qui semble confirmer la remarque de Hegel sur la vieille
Europe : à l’Allemagne la philosophie, à la France la
politique, à l’Angleterre le pragmatisme économique. Ces
cliniques laissent apercevoir un contrepoint entre des aliénistes
français construisant leurs élaborations dans des grands
asiles des classes populaires et celle des médecins des cliniques
universitaires allemandes recevant des patients aisés, plutôt
instruits dont certains intellectuels de renom, et portent la trace de
différents moments politiques et culturels. Deux phénomènes
essentiels du tableau s’unissent dans de cette rencontre : la fuite
des idées, sur laquelle se sont penchés les textes allemands
du 20ème siècle, et l’excitation, accompagnée
de son cortège corporel. Ainsi, la tonalité nietzschéenne
de certaines expressions utilisés par Ey (triomphe dyonisiaque ou
orgie bacchanale), montre de quelle manière ce philosophe colore
à travers la tradition clinique germanophone les conceptualisations
de la manie dans le 20ème siècle, en contrepoint à
celles plus descriptives et psychologiques de la tradition française.
Aussi, nous voulons également souligner que dans l’Etude N°
21, Ey prête aussi une grande attention au délire, dont la
manie semble de plus en plus éloignée dans les critères
contemporains, alors que les termes ont été synonymes pendant
des longues périodes de l’histoire. Placé dans la continuité
de ces prédécesseurs classiques, Ey se refuse à en
faire un phénomène secondaire. Il nous met en garde ainsi
contre la « fausse simplicité de la manie »,
aujourd’hui porté à son acmé dans le syntagme qui
réunit en langue anglaise ses quatre qualités essentielles:
glad,
bad, mad, sad. Il en va de même pour l’évidence de sa
situation dans le cadre nosographique des troubles bipolaires : nous pensons
avec Ey qu’il y a toujours lieu de s’interroger sur l’unité ou pluralité
de la manie, sur son appartenance spécifique à la psychose
maniaco-dépressive ou bien sur sa capacité à se retrouver
dans « l’évolution de nombreuses psychoses »
[9], comme il l’affirme. De tous ces faits, il ressort de la lecture de
l’Etude que la partition binaire qui comporte le terme bipolaire aujourd’hui
en usage est bien insuffisante.
Question
de style
L’Etude
s’ouvre par une longue observation, comme pour montrer que la clinique
reste l’âme de la pensée psychiatrique et dans laquelle Ey
ne rechigne pas à se faire le secrétaire de l’aliéné.
Cette observation, caractérisée de « typique
», permet de comprendre le sens qu’il donne à cette expression.
Dans ces pages initiales, tout y est, ou presque : de l’élation
et la fuite des idées, en passant par les questionnements éthiques
(politiques, théologiques ou sexuels) de la patiente qu’il présente,
jusqu’à la description des rapports entre l’être et son monde
où l’on devine l’ébauche de la métaphore délirante,
qui pourtant ne s’épanouit pas. L’observation signale aussi vers
la fin de l’accès une particularité fondamentale du tableau
: une discontinuité, la mise à distance de ses dires par
la patiente. Reste typique aussi pour Ey la survenue d’un accès
mixte, juste avant que toutes les manifestation présentées
ne s’apaisent et que la patiente reprenne sa vie professionnelle comme
si de rien n’était.
Profitons
de la touche benjaminienne qu’apporte Ey lorsqu’il caractérise sa
patiente de « petite bossue », pour dire deux mots sur
son style, volontiers métaphorique et parfois proche d’une prose
littéraire. Aidons nous ici des remarques du philosophe Jacques
Rancière [18, 19] pour donner un certain relief à la question.
D’après lui, « le Réel doit être fictionné
pour être pensé » et la littérature est cette
nouvelle rationalité du banal et de l’obscur qui s’oppose aux histoires
des grands faits et des grands personnages. Pour Rancière, Balzac
apparaît comme le paradigme de la promotion sociale et politique
des êtres quelconques, jusque-là voués à la
répétition et la reproduction de la vie nue. Alors si l’on
compare le style télégraphique de Clérambault à
celui de Ey, on comprend que ce sont les différents projets qui
les animent qui imposent leurs styles : celui du Maître du Dépôt
cerne toujours davantage l’isolement du trouble moléculaire de la
pensée, alors que celui de Ey tend à saisir la portée
anthropologique du tableau clinique et du sujet qui en est le protagoniste.
De là naît une mise en forme narrative qui de la vie nue et
obscure des malades quelconques vise à faire une histoire qui puisse
montrer une existence dans toutes ses dimensions. Ceci explique aussi son
recours méthodique à des disciplines de la subjectivité
telles que la phénoménologie et la psychanalyse, pour ensuite
donner forme à son propre horizon herméneutique théorico-clinique
: l’organo-dynamisme.
La
manie, discontinuité sémantique
Après
l’exposé du cas, Ey fait un point sur l’historique de la notion.
Il parcourt les lignes de fuite que le mot grec mania a occupé
dans l’histoire de la médecine, et c’est essentiellement pour dire
qu’on ne peut pas lire naivement la même signification du mot dans
Arétée de Cappadoce que chez Agop Akiskal. Qu’en quelque
sorte la coupure qui commence à se faire jour avec Pinel et la modernité,
ne nous autorise pas à projeter ce terme en arrière sans
risquer un contresens. Ce que manie veut dire répond à chaque
fois à un esprit du temps donné. En raccourci, au sens général
et parfois générique que le terme implique dans la littérature
médicale classique, se substitue un sens restreint sur lequel un
accord précaire s’est fait. Le sens de cet accord est strictement
moderne : excitation (ou exaltation), fuite des idées, évolution
discontinue (qui correspond plus ou moins à la notion de crise ou
d’aigu). Ey présente l’essentiel de la manie par deux caractéristiques
: volatilité de la vie psychique et désordre des fonctions
organiques. Les indications que Lacan donne visent aussi pour l’essentiel
ces deux phénomènes. On peut tenter une articulation à
travers les divers aspects que Ey catégorise comme la structure
positive et la structure négative de la manie, lesquels
chez Lacan prennent les noms de métonymie infinie et retour
mortel.

LA
FUITE DES IDEES
La
fuite des idées est considérée comme le cœur central
de la psychopathologie de la manie dans le registre intellectuel, cognitif
ou signifiant. Ludwig Binswanger et son ouvrage Sur la fuite des idées
[6] constituent la référence centrale au 20ème siècle.
Si Lacan est venu à formuler la manie comme "la métonymie
pure, infinie et ludique"dans laquelle "le sujet n’est lesté
par aucun a" [17], c’est peut être en lien avec le fait qu’il
s’y réfère de manière réitérée
(note1).
Le commentaire de ce même ouvrage et sa traduction résumée,
constituent la partie médulaire de l’Etude N° 21 de Ey. Cette
"transposition" [9] est restée pour des nombreux lecteurs
non germanophones la seule manière d’y avoir accès pendant
presque cinquante ans.
L’ordre
du désordre
Le
phénomène a été considéré parfois
comme un trouble de l’attention ou de la volonté qui ne permet pas
un choix correct de représentation, ou bien comme leur accélération
et allègement dues à une "hyperfonction" psychique
[6, 20]. L’idée qui oriente Binswanger, et Ey dans son sillage,
c’est qu’il y a un ordre dans tout ce désordre apparent. Dans son
ouvrage, il aborde les auteurs allemands ayant forgé cette notion,
pour s’arrêter au psychiatre Carl Wernicke qui distingue trois formes
de ce désordre : fuite ordonnée des idées,
fuite
désordonnée des idées et confusion maniaque.
Il critique les conceptions purement mécanicistes qui ne voient
qu’une accélération du flux des association des idées
et centre son analyse existentielle sur le "tout stylistique" [6]
d’une manière de vivre, une forme-de-vie à part entière.
Si bien l’ensemble reçoit une nette inspiration de Nietzsche, ce
qui va donner un caractère dialectique à son analyse c’est
une citation de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel :
"L’individu est ce qu’est le monde en tant que sien". Individu et
monde sont dans un rapport de co-appartenance, et cet individu aux idées
fuyantes se comporte dans son monde avec toutes les apparences du surhomme
nietszchéen [4]. Il "saute" à grand pas, se sert de
sa "grande gueule" pour ocupper avec sa parole un espace devenu
trop étroit, et semble jouir sans limites. Binswanger décrit
ce tout stylistique avec des métaphores a priori favorables qui
s’ordonnent selon différentes perspectives. Un paradigme chorégraphique
(la danse comme existence du corps, jouissive et sans finalité),
un paradigme festif (mode d’être optimiste dans une jouissance illimitée),
et le paradigme esthéthique d’une hybris (note2)
totalisante (la pure joie comme une existence où temps et horizon
sont illimités). Le sujet de la fuite des idées et son monde
constituent une expérience absolue de "se trouver disposé
[...] au milieu de l’étant en son ensemble", par lequel le
contact intime avec "l’événement de monde" dévoile
son excès. Il adopte trois modalités en dissonance avec cete
fête : le tourbillon, un éternel retour à...
et un régime particulier du désir, sur lequel nous
reviendrons.
Peut
être Binswanger pense encore au cas paradigmatique qui l’occupe pendant
les années qui précèdent la rédaction de l’ouvrage,
celui de l’historien de l’art Aby Warburg [12], un patient dont le turbulent
délire suscite l’attention de Freud. Ses travaux sur l’histoire
de l’art, ainsi que les outils de recherche qu’il invente, nourrissent
une réflexion sur le fonctionnement imaginaire caractéristique
de la manie, ce que Binswanger ne laisse pas échapper. Aussi, est
remarquable chez Warburg la notion de survivance d’une hybris héritée
de l’Antiquité (Nachleben der Antik) qui se retrouve également
dans les ouvrages de Freud. Par elle se continue le vieux lien entre art
et mélancolie (ou manie, selon les périodes), d’Aristote
au philosophe italien Giorgio Agamben (dans sa forme contemporaine, ce
lien se retrouve compressée par le marketing pharmaceutique qui
tend à faire de chaque artiste un bipolaire pour mieux faire passer
les thymorrégulateurs). Le dénouement du cas
Warburg se produit lors d’une intervention de Kraepelin qui, à
la surprise de tout le monde qui le croyait engouffré dans la schizophrénie,
porte un diagnostic d’état mixte qui précipite une guérison
inattendue [7].
Hybris
syntonique
Tentons
de préciser cette question d’une syntonie excessive avec le monde,
plus connue après Bleuler et Minkowski par hypersyntonie. Il est
remarquable que le social soit aussi omniprésent dans les passages
où Freud aborde la manie dans la Massenpsychologie [10].
Car la syntonie apparaît définie chez Binswanger comme un
désir de contact intime avec l’événement mondain.
Ce n’est pas l’euphorie qui le retient, car il sait fort bien que le maniaque
peut être courroucé, voire furieux. Il utilise le terme allemand
stimmung
(note3) qui vient recouvrir l’ouverture du sujet à
son monde. Ce point très important est masqué dans la traduction
du terme par humeur, tourné plutôt vers la machinerie
biologique du corps. « L’étant en tonalité »,
évoque un sujet en contact avec l’événement de monde.
Et ce monde, selon Binswanger, est un monde langagier de signification
personnelle.
The
dark side de la fuite
Ey
et Binswanger vont caractériser l’insouciance du maniaque
comme un trait essentiel de ce mode d’être-dans-le-monde, opposée
à la lourdeur d’un être lesté par le sérieux.
Cette légèreté de l’être est métaphorisée
par Binswanger comme un flottement labile, synchrone, présentant,
notion signifiant que le patient remplit complètement son espace
vécu "avec du présent", mais dont résulte la
conséquence que le passé et l’avenir ne sont pas, eux, présentifiés.
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la temporalité sui generis
de l’être maniaque, sans référence à une accélération
du temps chronologique. C’est le temps historicisant de la continuité
de la vie intérieure (note4) qui est bouleversé,
constituant le côté obscur de la fuite.
De
Heidegger, Binswanger reprend son existentiel fondamental : le souci
(sorge). Signe d’une existence authentique (note5),
il implique une vie problématique, prise au sérieux, centrée
sur une finalité, et en tout opposé à une existence
livrée à la pure joie festive, dans une sorte de version
métaphysique de la fable de la cigale et la fourmi. Cette opposition
le conduit à concevoir l’existence dans la fuite des idées
comme un renoncement à la "connaissance authentique" [6],
ce qui se retrouve particulièrement dans le rapport au langage spécifiquement
maniaque. Dans les abordages lacaniens qui spécifient le trouble
du langage maniaque [21], ce point est saisi par la production d’une succession
de S1, S1, S1..., sans qu’aucun binaire S1-S2 ne vienne boucler le sens.
Cela implique qu’il n’y a pas de la part du sujet de reprise du
savoir de son expérience [11]. Pour Binswanger ce qui se produit
ici est un nivellement à la fois langagier, spatial et temporel
: les sons perdent leur caractère de signes, l’homme aux idées
fuyantes ne pense pas à leurs significations, mais glisse progressivement
vers une manipulation ludique du matériau sonore, marquant un télescopage
de la sphère de la signification et celle de l’objet. Dans ce nivellement
se produit un "flottement neutre de l’être dans le tout" [6]
où le temps et l’horizon deviennent illimités, alors que
le nivellement de la spatialité rend le monde large et plastique.
L’attitude
d’insouciance et d’optimisme conduisent à un vagabondage
du savoir et du monde qui dissout toute problématique et qui trompe
le patient sur la possibilité d’être "heureux mais sans
désir"[6]. Cette expression lumineuse de Binswanger éclaire
de manière étrange certains aspects de l’évolution
de nos sociétés vers une aspiration hédonique au bien-être
sans stress, dans laquelle Nietzsche verrait le portrait du Dernier homme
[25], Kojève et Agamben celui l’homme de la fin de l’histoire (note6).
Notons que Ey se sert d’une célèbre terminologie économique
pour contester les métaphores de la manie comme une "plus-value"
[9] existentielle. Pour cela, il va préciser la structure négative
de la manie, c’est-à-dire son aspect fondamental d’impuissance.
Avec Binswanger [6], il réunit les termes descriptifs imaginaires
de "largeur de vue", "grande gueule", "pensée sautillante
au style télégraphique", sous la bannière de la
volatilité
et de l’insouciante légèreté. Si cela peut
tromper le patient (et parfois les cliniciens) sur un côté
triomphant et libérateur, il comporte aussi, à l’image du
ruban de Moëbius, un autre versant moins orienté vers la volonté
de puissance et plus marqué par un insupportable éternel
retour. C’est le retour mortel du langage [11] abordé par Lacan
dans le deuxième trait clinique fondamental : l’excitation.
 L’EXCITATION
L’EXCITATION
Nous
pouvons dire que ce phénomène s’associe au terme manie depuis
l’antiquité. Si l’on envisage La maladie sacrée d’Hippocrate
comme traitant de quelque chose de plus que la seule épilepsie,
on peut lire déjà qu’elle sert à séparer deux
figures cliniques : folie agitée et folie tranquille. Cela se lit
aussi dans la distinction que fait Griesinger entre la manie et la monomanie
exaltée dans son célèbre ouvrage Pathologie et
thérapeutique des maladies mentales [13]. De même, les
textes de Pinel et Esquirol mettent en relief ce phénomène,
si peu intellectuel et plutôt musclé, mais qui dépeint
un sujet qui a perdu tout contrôle et à qui lui échappe
toute volonté de puissance.
Du
laisser aller...
En
bref, l’on peut faire ressortir dans la manie une implication particulière
du corps dans le comportement relationnel de sa vie sociale. Sans aller
plus loin, tous les auteurs s’accordent pour signaler souvent un comportement
sexuel débridé qui ne s’articule pas avec les règles
habituelles des transactions sexuelles, ni avec leurs transgressions inhérentes
: les partenaires peuvent défiler autant que les signifiants. Mais
le corps est impliqué aussi dans sa vie nue, dans son intimité
la plus biologique. Ici, l’hybris, l’excès, envahit le corps
du sujet et finit par dérégler les fonctions vitales mêmes.
Cet ouragan dyonisiaque, ce « jouer et jouir », ou cette
« fête du moi » comme le dit Ey en reprenant Freud,
s’avère comporter un versant déréglé et sans
cesse, qui semble diriger le sujet à la perte de toutes les formes-de-vie.
Lacan y fait référence dans Télévision [17]
lorsqu’il évoque le retour forclusif d’un tranchant mortel dans
l’excitation maniaque. Ey les appelle les « expréssions
somatiques de cette déstructuration » [9]. Il s’y arrête
pour nous rapporter non seulement l’hyperkinésie « diffuse
et complexe » ou l’insomnie rebelle, signes classiques, mais
aussi les perturbations du tonus neurovégétatif, les poussées
congestives thyroïdiennes, les paroxysmes gonadiques, les altérations
cardio-vasculaires, qui s’ajoutent à l’antique altération
des voies digestives, et auxquelles il pense que le psychiatre doit porter
toute son attention. Le trouble moléculaire de la pensée
se retrouve dans un trouble des molécules dont peut résulter
la mort du vivant. Car, bien que très rare selon lui, la mort est
à l’horizon de ce tableau clinique, surtout lorsque toute forme-de-vie
se dissout dans les des tableaux décrits comme « manies
confuses », « manies d’épuisement »
ou « délire aigu » [9].
Si
l’on suit Ey et Lacan, l’excitation maniaque est donc un bouleversement
mortel du rapport zoé/bios (note7) exposé
par Agamben dans ses ouvrages. Elle est l’excès d’une vie paradoxale
qui désorganise les besoins vitaux du corps mettant à jour
la vie nue. En ce sens, le tableau psychiatrique de la manie produit des
effets analogues à certains dispositifs politiques, dont le paradigme
reste le camp. De son côté le philosophe Slavoj Zizek [24]
établit des passerelles entre cet excès de vie paradoxale,
la pulsion freudienne et la marche auto-propulsée et sans fin à
la croissance de l’économie capitaliste, dont le comportement cyclique
commence à être perçu en même temps que cette
maladie psychiatrique cyclique.
...
à l’impossibilité de s’arrêter
Ce
ne-pas-pouvoir-s’arrêter nous permet de faire le point sur l’utilisation
des termes positif et négatif chez Ey. Pour lui, ce ne sont pas
des éléments isolés pouvant s’additionner ou se soustraire,
ni susceptibles d’être mesurés ou évalués par
des échelles distinctes. Il s’agit bel et bien du même
fait clinique envisagé dans des perspectives différentes.
Ey allie toujours pour le même phénomène une impossibilité
(ou impuissance) à une nécessité. Dans le cas
particulier du maniaque cela se traduit par une vertigineuse impossibilité
de s’arrêter qui finit par transformer la fête dyonisiaque
et le besoin de dévorer, en un être-dévoré,
le moment dans lequel la "grande gueule" d’une oralité démesurée
s’avère être celle de l’Autre.
LE
DELIRE MANIAQUE
Réparti
entre positif et négatif, abordons le délire que Ey considère
comme un fait majeur de la crise maniaque. On peut lire dans un texte plus
récent que « plus de la moitié des patients maniaco-dépressifs
présentent des idées délirantes » [8]. Ces
faits massifs s’avèrent plutôt incommodants pour la tentative
de faire passer la psychose maniaco-dépressive dans le trouble bipolaire.
A ce sujet, notons que la notion de polarité est aussi un
héritage du romantisme allemand du 19ème siècle. A
ses origines nous trouvons Goethe, le lingüiste Abel qui inspire à
Freud son texte sur le sens opposés des mots, et Warburg avec sa
théorie de la bipolarité des icônes de l’art [12].
Si le terme est déjà utilisé par Wilhelm Weygandt
(note8), l’élève de Kraepelin chez qui celui-ci
puise l’essentiel sur les états mixtes, force est de constater que
ni Kraepelin, ni Binswanger, ni Ey ne retiennent la terminologie. L’on
doit attendre le psychiatre allemand Karl Leonhardt qui, dans la perspective
d’isoler une maladie unipolaire d’une autre bipolaire, fixe le terme aujourd’hui
en usage.
Le
délire verbal et ses stabilisations
Sur
la question du délire, Ey est très clair : "On repète
souvent que la manie n’est pas un délire" [9]. Mais pour lui,
la fuite des idées, l’exaltation imaginative, les propos inventifs
et la fantaisie ludique sont déjà un "délire naissant".
Il refuse toutes les approches du fait délirant maniaque qui le
considèrent comme une "association contingente". Même
si Lacan n’aborde pas directement la question, il introduit pour la manie
une distinction intéressante : "c’est la non-fonction de a qui
est en cause, et non pas simplement sa méconnaissance". Cette
forme particulière de forclusion livre le sujet "sans aucune
possibilité de liberté, à la métonymie pure,
infinie et ludique, de la chaîne signifiante" [17]. Ces indications
aident à saisir le caractère hautement instable, fuyant et
léger de toute tentative de métaphore délirante. Car
les tentatives ne manquent pas, mais elles ne foncionnent pas comme dans
les autres psychoses délirantes.
Notons
qu’avec Kraepelin [14], Ey considère avec banalité le fait
délirant de la manie. Il est intéressant de lire chez ces
auteurs que le thème ne donne aucune indication précise pour
caractériser le délire. Nous ne retrouvons pas d’indice qui
puisse ressembler à ce qu’aujourd’hui on caractérise comme
non-congruent à l’humeur, et se cotoyent dans les observations cliniques
des idées de persécution, d’influence, hypocondriaques, des
expériences hallucinatoires, etc. Certes, Ey remarque la fréquence
de quelques déclinaisons classiques comme le délire de grandeur
– implicite au monde de la fuite des idées -, mais il préfère
mettre en avant ce que Séglas appelle le "délire verbal"
[9], dont les caractéristiques sont les mêmes que celles qui
constituent la structure négative que Ey vient de préciser
pour la fuite des idées : mobilité, redondance verbale, variabilité,
inspiration changeante. Comme le dit Binswanger, "rien n’est définitif"
[6].
Ces
indications ont leur intérêt dans l’attitude habituelle des
sujets lorsque l’excitation cesse et le tourbillon se stabilise. Il est
classique de noter lorsque le sujet se calme l’absence d’un travail délirant.
Dans le contrepoint entre délire et savoir, d’après Binswanger,
"l’homme maniaco-dépressif "ne veut plus savoir" et [...]
perd
la possibilité de développement biographique "authentique""
[6]. Pour ce qui concerne le temps de la guérison, il remarque une
conséquence facheuse : la personne n’arrive pas "à un
nouveau présent, un présent nouveau, que l’existence tourne
bien plutôt en rond, et donc, après que les bruits de la "psychose"
se sont évanouis, elle se retrouve à la même place
à laquelle elle s’est déjà trouvé auparavant"
[6]. Cette disposition subjective fondamentale semble marquer le destin
des métaphores délirantes, fréquentes mais aussi très
instables.
LES
ETATS MIXTES
Il
existe enfin une forme de l’être maniaque qui met à mal les
conceptualisations réductionnistes : l’état mixte.
Nous avons dit que pour Binswanger et Ey, l’existence insouciante et la
vie problématique orientée par le souci se situent aux antipodes.
Cependant, chez Binswanger ces deux pôles ne constituent qu’un "cas-limite"
[6], une abstraction métaphysique. En réalité, pour
lui dans la clinique toute fuite des idées contient toujours un
ordre qui la rend impure. L’opposition est toujours mixte : elle renferme
soit une problématique prise trop à la légère,
soit une joie existentielle troublée moralement. Le maniaque tend
à la réalisation elliptique de son horizon sans y arriver.
Ce fait est décisif pour l’analyse que poursuit Binswanger de la
co-appartenance de l’homme maniaco-dépressif à son monde
: l’essentiel n’est pas dans la bipolarité, mais dans le fait que
le monde est toujours déjà divisé par la contradiction.
Il est "l’homme qui voit et a le monde divisé dans son fondement
le plus profond" [6]. Et c’est dans l’état mixte que se révèle
pour Binswanger et Ey la vérité de l’homme maniaco-dépressif.
Il est une forme de vie brisée, ni problématique quant à
l’existence, ni problématique quant à l’esthétique.
Alors, cela ne doit pas nous surprende de lire chez Kraepelin [14] ou son
élève Weygandt [23] que l’ensemble des états mixtes
constituent la plus grande partie des états de la folie maniaque-dépressive
(note9).
La
surprise est plutôt voir que dans l’Etude de Ey la question ne l’occupe
pas plus et qu’il repousse à plus tard l’occasion de revenir sur
ce "point fondamental" [9]. Il se contente d’énumérer
ce qu’établit Kraepelin sur ces états et d’énoncer
quelques considérations autour des psychanalystes sur le conflit
entre le Sur-moi qui dominerait la mélancolie et le Ça qui
dominerait la manie. La question est d’autant plus forte que la complexité
et la richesse clinique de ces états lui fourniraient ses meilleurs
arguments contre "les théories thymiques de la maladie considérée
comme un trouble pour ainsi dire mécanique de l’humeur" [9].
La réponse se trouve dans le plan d’exposition de sa doctrine de
la destructuration des niveaux de la conscience dans les psychoses aiguës
[5]. Le niveau de destructuration temporelle-éthique qu’il
construit en parallèle dans l’Etude N° 21 sur la manie, et N°
22 sur la mélancolie, occupe une place stratégique dans son
Etude N° 23 sur les bouffées délirantes. C’est
là que l’on peut retrouver les tableaux que Kraepelin ou Weygandt
nomment états mixtes, en compagnie des états oniroïdes
de Mayer-Gross. Car, une partie de ces états se recouvre avec ce
que la clinique française nomme depuis Magnan bouffées délirantes.
Il s’agit là d’une problématique encore très actuelle,
et d’une région clinique où se multiplient des tableaux sans
profondeur psychopathologique et porteurs potentiels de précipitations
diagnostiques. Alors, pourquoi Ey s’autorise-t-il à cette immixion
au risque d’une confusion? Nous croyons que c’est seulement en raison de
sa conviction que la manie est une crise dans le sens hippocratique
du terme, c’est-à-dire qu’elle implique aussi un processus de réaménagement
subjectif qui oriente autant que l’état aigu pour cerner la modalité
précise qui relie le sujet à son dire.

LE
TEMPS D’UNE PAUSE
Il
reste que si jusqu’ici l’accent a été mis sur la légèreté
de l’être maniaque, ou sur son côté illimité
et sans cesse (même lorsque la mort est à l’horizon), nous
avons négligé un fait essentiel et fondateur de la notion
moderne de la manie : sa discontinuité. C’est-à-dire,
cette capacité plus ou moins surprenante des patients de marquer
une pause dans la dérive métonymique et infinie de la manie.
Dans l’Etude, Ey évoque l’idée de pause comme synonyme de
réflexion, de pondération, le propre de "la structure
temporelle-éthique en tant qu’elle oriente et tempère le
sens du courant de son vécu" [9]. Nous donnons ici à
ce terme un sens nettement différent pour nommer la capacité
du maniaque de sortir des rails de la manie, très différente
de celle dont parle Ey qui est plus proche de la notion de la reprise
de Kierkegaard (note10).
Il
est reconnu de tous temps à l’homme maniaque la capacité
de suspendre spontanément l’excitation, et de passer dans une phase
différente souvent nommée intercritique, qui peut
aller de quelques instants à toute la vie. Cette pause si peu tourbillonnante,
peut aussi nous renseigner sur l’essentiel. A défaut de se satisfaire
de l’idée, après tout si peu médicale, de rémission,
il vaut mieux questionner cette remarque de Karl Abraham pour qui le patient
"n’est pas vraiment "sain" même dans l’intervalle "libre""
[1]. C’est en tout cas ce que pense Kraepelin, pour qui des "petites
particularités" permanentes nommés "états fondamentaux",
sans être précisément pathologiques "pourraient
avoir pour l’obervateur averti" le caractère de "légers
indices" [14] pour les manifestations de la folie maniaco-dépressive.
Ce terrain, abandonné aux tempéraments, mérite un
effort clinique pour dégager les phénomènes élémentaires
essentiels (si l’on vise les troubles moléculaires de la pensée),
ou pour comprendre le monde de la personne maniaco-dépressive (si
l’on est à la recherche des structures anthropologiques propres
à la maladie). Nous les croyons indispensables pour le diagnostic
et la thérapeutique, capables de nous renseigner sur le devenir,
et sur les occasions à prendre pour des interventions appropriées.
Car, ils montrent peut-être moins de différences entre la
crise et l’état intercritique que ce à quoi l’on pouvait
s’attendre. Ils forment ce fond commun clinique et thérapeutique
qui constitue l’âme de la praxis psychiatrique.
Dans
cette orientation, terminons ces propos sur l’Etude de Ey par quelques
directions à explorer :
-
Qu’en est-il du statut subjectif de cette pause intercritique qui
réunit la non reprise du savoir et la difficulté à
élaborer un présent nouveau, comme dit Binswanger? Car souvent
on fait face à une certaine réticence à reprendre
le vécu de la crise, vu que le patient ne veut plus rien savoir
du savoir jadis exposé.
-
Quelle est cette homéostase que nous avons explicité comme
un contentement sans désir, signalée aussi par Binswanger
et qui se retrouve dans ce conformisme acharné, caractérisé
comme une suridentification à la normalité [22] dans
laquelle le sujet est aussi lisse que son monde nivelé par sa moyenne?
Quel sens peut avoir dans cette atonalité du monde (note11)
[25] la notion de co-appartenance?
-
Enfin, comment procéder avec la volatilité de l’être-au-monde,
qui témoigne de l’"ambigüité insupportable" [9]
de la légèreté de la personne maniaque?
Cet
ensemble composé par la crise, l’intercrise et l’état mixte,
montre l’insupportable précarité des personnes qui maintiennent
leur être dans une pause suspensive, avant de plonger éventuellement
une nouvelle fois dans l’hybris maniaque, mélancolique ou mixte.
Ey le remarque, la "psychogenèse du "choix" de la crise"
relève d’une insondable précipitation de l’existence, bien
qu’elle soit moins littéraire que chez les personnages de Milan
Kundéra. En ce point, la relecture des Etudes de Ey s’avère
toujours féconde, car elle invite à ne pas nous en contenter,
et nous incite à poursuivre la clinique des décisions insoutenables.
BIBLIOGRAPHIE
1) ABRAHAM Karl,
Œuvres complètes, Paris : Payot, 1965.
2) ADAM Rodolph,
Lacan et Kierkegaard, Paris : Presses Univeristaires de France, 2005.
3) AGAMBEN Giorgio,
L'ouvert. De l’homme et de l’animal (2002), Paris : Rivages Poche, 2006.
4) ASSOUN Paul-Laurent,
Freud et Nietzsche, Paris : Quadrige/Presses Universitaires de France,
1988.
5) BELZEAUX Patrice,
L'actualité de la manie selon Henri Ey, Psychiatrie Française,
N° 3/01 vol XXII, décembre 2001.
6) BINSWANGER
Ludwig, Sur la Fuite des idées (1933), Collection Krisis, Grenoble
: Jérôme Millon, 2000.
7) BINSWANGER
Ludwig, WARBURG Aby, La Guérison infinie, Paris : Bibliothèque
Rivages, 2007.
8) BOURGEOIS
Marc, VERDOUX Hélène, Clinique des troubles bipolaires de
l’humeur (le spectre bipolaire), in Les troubles bipolaires, sous la dirction
de Th. Lemperière, Paris : Acante-Masson, 1995.
9) EY Henri,
Etudes psychiatriques, Tome III (1954), vol II, Perpignan : Crehey, 2006.
10) FREUD Sigmund,
Psychologie des foules et analyse du moi (1921), in Essais de psychanalyse,
Paris : Payot, 1987.
11) FRIDMAN Pablo,
MILLAS Daniel, L’exaltation maniaque, Les morts du sujet, in Le Conciliabule
d’Angers, Effets de surprise dans les psychoses, Paris : Agalma - Le Seuil,
1997.
12) GOMBRICH
Ernst, Aby Warburg. Una biografia intelletuale (1970), Le Comete, Milano
: Feltrinelli, 2003
13) GRIESINGER
Wilhem, Patología y terapéutica de las enfermedades mentales
(1845), Buenos Aires : Polemos Editorial, 2da parte, 1997.
14) KRAEPELIN
Emil, Cent ans de psychiatrie, suivi de La folie maniaco-dépressive
(1913), Bordeaux : Mollat, 1997.
15) KUNDERA Milan,
L’insoutenable légèreté de l’être (1984), Paris
: Folio Gallimard, 1989.
16) LACAN Jacques,
Autres écrits, Paris : Seuil, 2000,
17) LACAN Jacques,
Le Séminaire Livre X, L’angoisse, Paris : Seuil, 2004.
18) RANCIERE
Jacques, Le partage du sensible, Esthétique et politique, Paris
: La Fabrique Editions, 2000,
19) RANCIERE
Jacques, Politique de la littérature, Paris : Galilée, 2007.
20) SAUVAGNAT
François, Fenómenos elementales y estabilizaciones en las
psicosis maníaco-depresivas, Rev. Assoc. Esp. Neuropsiq., vol XVIII,
1998, pp. 457 – 470.
21) SOLER Colette,
La manie, Péché mortel, in L’inconscient à ciel ouvert
de la psychose, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2002.
22) TELLENBACH
Hubertus, La Mélancolie (1976), Paris : Presses universitaires de
France, 1979.
23) WEYGANDT
Wilhelm, Su gli stati misti della psicosi maniaco-depressiva (1899), Pisa
: Edizioni ETS, 1995.
24) ZIZEK Slavoj,
The parallax view, Massachusetts Institut of Technology Press, 2006.
25) ZIZEK Slavoj,
Violence, London : Profile Books, 2008.
Autres textes
Aby
Warburg, la fuite, la pause
El
goce ilimitado de la Ninfa
Warburg
avec Binswanger
Angustia
biopolítica
L'anxiété
morbide Etude bioplitique de Henri Ey
Giorgio
Agamben et la mélancolie : philosophie de la clinique
Ey
et Lacan : la folie entre corps et esprit
Le
capitaliste fou
Transformations
délirantes ou le pousse à la femme
_______________________________
NOTES
1) Quelques références
: "Le problème du style et la conception psychiatrique des formes
paranoïaques de l’expérience (1933) ; "Psychologie et esthétique.
Compte-rendu sur l’ouvrage de E. Minkowski, Le temps vécu" (1935)
; Intervention sur l’exposé de J. Rouart "Du rôle de l’onirisme
dans les psychoses de type paranoïaque et maniaque-dépressif",
l’Évolution Psychiatrique (1936). Sur la fuite des idées
est cité aussi dans "Etude sur l’hallucination" (1968), Scilicet
1.
2) Hubris
: ce terme grec signifie depuis la tradition antique la démesure,
l’excès, désignant néanmoins quelque chose d’inhérent
à la nature humaine.
3) Ce terme allemand
possède plusieurs significations tournant autour de tonalité
affective, tonalité émotive, disposition affective, émotion,
athmosphère, ambiance, etc.
4) Cette notion
de Binswanger s’oppose à celle de fonction vitale et désigne
le rapport du sujet aux contenus de son vécu.
5) Il est pour
Heidegger une structure a priori du Dasein, impliquant un refus
absolu d’être substance. La problématique et la finalité
qui lui sont articulées, aident à comprendre pourquoi les
stimmungen de l’angoisse constituante et de l’ennui lui sont associés.
Ils sont la marque d’une existence authentique possible, prise dans les
contingences d’une vie faite de sens et de non-sens.
6) Slavoj Zizek
nomme "biomorale" l’articulation actuelle de nombreuses disciplines
autour de l’impératif "soyez heureux!". Des indices de "bonheur"
fleurissent dans des études sociologiques afin de déceler
des comportements nocifs au bien-être et déterminer le style
de vie qui correspond le mieux à chaque style de personne. Il existe
un Journal of happiness studies consacré à la recherche sur
la qualité de vie.
7) Agamben [3]
considère ce rapport comme le « conflit essentiel »
de la machine métaphysique anthropologique, à travers ses
déclinaisons théologiques, philosophiques, scientifiques
et enfin politiques. Il constitue le lieu du conflit entre les notions
d’homme et d’animal, entre l’ouvert et le non-ouvert.
8) « Il
est connu que chez un malade mental alors que les symptômes d’une
polarité peuvent se manifester de façon très prononcée,
ceux de la polarité opposée, présents au même
moment, peuvent être très effacés » [23].
9) Ey pense que
ce fait suffirait pour "imposer aux psychoses maniaco-dépressives
un rythme à trois temps" [9].
10) La reprise
chez Kierkegaard se distingue du ressouvenir en cela qu’il est un passé
qui se reprend par l’ouverture du présent vers l’avenir [2].
11) Zizek reprend
ici la notion de monde atone élaborée par Alain Badiou
pour caractériser l’esprit de notre temps (ou plutôt son manque
d’esprit...).